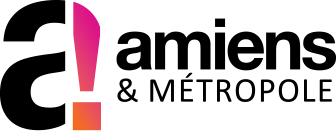Le velours d'Amiens
La renommée du velours amiénois n’est plus à faire. Mais en connaissez-vous son origine ? Le trésor d’archives des Archives municipales et communautaires d’Amiens s’intéresse à l’histoire de ce tissu si particulier.

01.10.2025
Depuis le Moyen-Âge, la ville d’Amiens est reconnue pour l’industrie de la waide, une plante qui permet de teindre les vêtements en bleu. Cette activité se développe dès le XIIe siècle mais ne prend de véritable importance qu’à partir du milieu du XIIe siècle lorsque le bleu change de statut et devient une couleur en vogue, d’abord dans l’iconographie, puis dans le reste de la société. En effet, le bleu devient la couleur mariale par excellence. Les rois Philippe II Auguste et Louis IX, dit Saint-Louis, commencent alors à se parer de vêtements bleus qui deviennent symboliquement la représentation du divin. Ce changement de statut est tel que le bleu devient l’un des emblèmes du royaume de France lorsque les capétiens l’ajoutent à leurs armoiries. Cette nouvelle mode permet à la ville d’Amiens de s’enrichir rapidement car la couleur est très recherchée. Cette activité florissante contribue à financer une majeure partie des travaux de la cathédrale, une statue représentant un couple de waidier lui rend d’ailleurs hommage sur la façade sud de l’édifice. Afin de maîtriser toute la chaîne textile, la ville se dote dès le XIIe siècle des premiers métiers à tisser et devient une ville drapière de premier plan qui fabrique, teint et revend les textiles dans toute l’Europe. La matière utilisée est principalement de la laine fabriquée dans les campagnes environnantes ou importée d’Angleterre. Au XVIe siècle, le savoir-faire d’ouvriers flamands permet la diversification de la production textile grâce au traitement d’autres matières telles que la soie ou le satin. Au XVIIe siècle, l’arrivée progressive d’une nouvelle matière dédiée à l’ameublement va révolutionner l’industrie amiénoise : le velours.
En 1755, Alexandre Bonvallet crée la manufacture royale d’Amiens. Elle est spécialisée dans le Velours d’Utrecht, un tissu dédié à l’ameublement. L’usine Bonvallet est réputée pour le procédé révolutionnaire de son créateur qui permet d’imprimer sur le velours des motifs en relief. Dès lors, les velours d’Amiens rivalisent avec les réputés velours de Gênes. L’usine reçoit même la visite de Napoléon 1er en juin 1803. Le velours textile s’est également développé à Amiens à la fin du XVIIIe siècle grâce à l’implantation de l’entreprise Morgan-Delahaye en 1765. Au fil des années, la spécialité amiénoise devient le velours de coton côtelé qui permet la fabrication de vêtement de travail d’une grande solidité. Au XIXe siècle, la filière connaît une importante crise en raison de la concurrence anglaise. Contrairement aux usines d’outre-manche, les industriels amiénois n’ont automatisé leurs machines que tardivement. Les innovations viennent principalement de l’entreprise Cosserat, implantée depuis la fin du XVIIIe siècle dans la ville. Le premier tissage mécanique n’est installé qu’à partir de 1857 grâce aux pièces importées d’Angleterre par l’entreprise. Le début du XXe siècle est marqué par le déclin de toute la filière textile en raison des guerres et des différentes crises économiques qui égrainent le siècle. Malgré cela, l’économie du velours croît de nouveau après la Seconde Guerre mondiale. Pour preuve, en 1948, trois fabricants de velours d’ameublement rassemblent 500 ouvriers : Delaroière et Leclercq, les Tissages de Picardie et l’usine René Dewas. Les crises économiques et industrielles de la fin du XXe siècle n’épargnent cependant pas les entreprises amiénoises qui ferment les unes après les autres. La dernière usine, celle de l’entreprise Cosserat, ferme définitivement en 2012.
Le trésor d’archives est une photographie représentant la visite de l'usine de velours Delaroière & Leclercq par des membres du conseil municipal d’Amiens en 1988. On aperçoit les rouleaux permettant de gaufrer le tissu. Ce procédé mécanique permet d’imprimer un motif sur le tissu grâce à des cylindres chauffés qui marquent la matière sans l’abîmer. L’entreprise Delaroière & Leclercq fabriquait du velours d’Utrecht dédié à l’ameublement. Elle a occupé les locaux du 50 rue Riolan de 1905 jusqu’à sa fermeture en 1990. Une partie des locaux abrite aujourd’hui les Archives municipales et communautaires d’Amiens.
Le document :
Cote archives : 9Fi1391
Date : 1988
Support : papier photo
Condition d’entrée dans les fonds : Versement
Conditions de conservation : Dans une boîte classeur neutre.
Description : Visite de l'usine de velours Delaroière & Leclercq par des membres du conseil municipal en 1988. On aperçoit les rouleaux permettant de gaufrer le tissu.
D’autres documents iconographiques vous attendent sur notre page Facebook