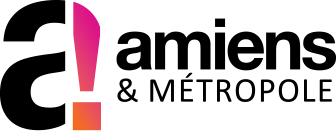L'Amiens'solite
Le JDA vous révèle dix détails insolites des rues d’Amiens. Histoire de briller dans vos soirées de l’été et de lever la tête même quand on pense tout connaître.

04.07.2023
1) La maison de l’Atlante
Sa façade en impose avec ce personnage sculpté soutenant sur son dos le balcon du premier étage. Bienvenue au bout de la rue Jules-Lardière, au croisement de la rue des Cordeliers en plein centre-ville. Vous voici devant la bien nommée maison de l’Atlante, (Atlante, dérivé du mot Titan et de la mythologie grecque Atlas, définit justement en architecture les figures masculines supportant une charge). Mais la particularité de la maison de l’Atlante réside autant dans sa façade que dans sa… profondeur : 1,50 m, conférant à l’ensemble une sensation de décor de théâtre. « À l’intérieur, il n’y a qu’une échelle de meunier qui dessert de simples paliers », nous glisse le guide-conférencier Christian Sutcliffe. La maison de l’Atlante fut d’abord construite au XVIIIe siècle rue des Sergents. Au début du XXe siècle, le nouveau propriétaire voulait la détruire et fit don de la façade à la Société des antiquaires picards qui l’installèrent ici juste avant la Grande Guerre.
Des histoires de façades qui se déplacent, Amiens en recèle. La maison du Sagittaire, en face du palais de justice, était à l’origine un chapelier situé rue des Vergeaux. La façade du théâtre (l’actuel LCL) fut, elle, décalée de quelques mètres pour aménager la rue des Trois-Cailloux dans sa configuration actuelle.


2) Les japonaiseries de la rue des Cordeliers
À l’angle de la maison de l’Atlante, une autre curiosité vaut la peine de lever la tête. Une maison en brique jaune (assez rare à Amiens) présente une magnifique mosaïque, œuvre de Pierre Ansart, descendant des célèbres Duthoit et père de Gérard Ansart, lui aussi architecte et décorateur. « Aujourd’hui, on dirait “style zen”, on peut parler pour l’époque de japonaiserie. Nous sommes alors en plein Art déco », décrypte Christian Sutcliffe.


3) René Lamps et Gilles de Robien sur le beffroi
Il faut être attentif. Au-dessus de la porte d’entrée du beffroi d’Amiens, deux petites figures ont été sculptées de part et d’autre, regardant les passants. À gauche, le personnage de quelques centimètres a une casquette d’ouvrier et une faucille à la main. À droite, son homologue présente un brushing impeccable. Il s’agit d’une petite facétie des tailleurs de pierre au moment de la restauration du monument, resté en ruine jusqu’en 1988, qui ont représenté René Lamps (maire de 1971 à 1989) et Gilles de Robien (maire de 1989 à 2008). « Le premier, communiste, qui fut enseignant, avait décidé cette restauration. Le second, l’a inaugurée, resitue Christian Sutcliffe. Il goûta d’ailleurs peu à cette tradition des tailleurs de pierre. »


4) Rue Tournecoëffe
Elle fait partie des plus petites rues d’Amiens. Elle fut même la plus étroite. La rue Tournecoëffe, désormais impasse, entre la place Vogel et le centre Léo-Lagrange, près de la Maison Cozette, ne vaut le détour que par son nom original. Car, dans ces goulets, le vent s’engouffrait et faisait tourner les coiffes des badauds…

5) La queue de vache
C’est la carte postale d’Amiens : le quai Bélu. Mais avant de prendre le nom d’un ingénieur des Ponts et Chaussées qui s’occupa du canal de la Somme, le quai portait le nom de rue de la Queue-de-Vache car c’est là, dans un Amiens à la forte activité agricole et laitière, que l’on faisait boire les vaches. De leurs fenêtres, les riverains ne voyaient que leur queue…

6) La place Saint-Michel avec une statue de… Pierre l’Ermite
La statue de la place Saint-Michel qui donne accès au parc de l’Évêché derrière la cathédrale a des airs de Jules Verne. Mais il ne s’agit ni de l’auteur amiénois, ni de saint Michel comme le nom de la place pourrait le laisser supposer. Ici, se tenait jusqu’à la Révolution française l’église Saint-Michel, détruite en 1790. La statue est celle de Pierre l’Ermite, chanoine de Huy (Belgique), prédicateur de la première croisade et né à Amiens.


7) Les maisons néomédiévales face à la cathédrale
Elles font leur effet. Face à la cathédrale, d’imposantes demeures jouent de références gothiques. Elles sont pourtant sept siècles plus jeunes que Notre-Dame. En 1903, l’architecte Edmond Douillet est chargé d’aménager le parvis et construit six maisons néomédiévales. Quatre seront détruites par les bombardements de mai 1940. Sur celle à l’angle de la rue Henri-IV, Douillet est représenté dans un bas-relief où on le voit touché par la vision d’un ange.
8) Roland Dorgelès l’Amiénois
C’est une amiénoise classique, rue Vascosan, dans le quartier Sainte-Anne. C’est là que Roland Dorgelès, de son vrai nom Lecavelé, a vu le jour le 15 juin 1885. Roland Dorgelès, fils de marchands de tissu, fait partie de ses écrivains-soldats qui racontèrent la guerre, l’odeur du sang, la hantise de la mort. Sans héroïsme. Il obtint le Prix Femina en 1919 pour ses Croix de bois. La légende raconte qu’il aurait raté le prix Goncourt à une voix. Il intègrera en tout cas l’académie Goncourt, y côtoyant deux autres Picards : le Péronnais Mac Orlan et le Saint-Quentinois André Billy. Roland Dorgelès, homme de Montmartre, est à l’origine de l’expression “Drôle de guerre” et l’auteur d’un télégramme à Hitler : « Je vous souhaite un joyeux anniversaire, à condition que ce soit le dernier ! ».

9) Fenêtres murées et le mythe de l’impôt
Beaucoup d’amiénoises, ces maisons en briques caractéristiques de la ville, présentent une fausse fenêtre murée au-dessus de la porte d’entrée. Et l’on a déjà entendu, en se baladant, des passants dire : “Oui, les gens payaient des impôts sur les fenêtres et muraient certaines ouvertures… ”. Il y a dans cette affirmation un peu de vrai mais surtout un peu de faux. Oui, il y a bien eu en France jusqu’en 1926, un impôt sur les portes et les fenêtres qui incitaient les propriétaires à limiter le nombre d’ouvertures. Mais, ce qui peut ressembler à une fenêtre murée est en réalité un geste architectural pour garder l’harmonie d’une façade et éviter un pan de mur entièrement plat.

10) Les biscuits de la rue Gaulthier-de-Rumilly
Certains ont pu passer devant sans rien remarquer. Rue Gaulthier-de-Rumilly, il reste encore deux magnifiques façades estampillées Vieville, nom de cette biscuiterie fondée en 1887, totalement disparue depuis. Sont pourtant restées intactes les façades de l’usine à gauche et la maison directoriale en face. « On est là typiquement en fin d’Art nouveau », analyse notre expert Christian Sutcliffe qui évoque une autre chocolaterie Magniez-Baussart, installée Faubourg de Hem et rachetée en 1963 par Trogneux (https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Les-Archives-municipales-et-communautaires/A-la-decouverte-du-patrimoine-amienois/La-chocolaterie-Magniez-Baussart).